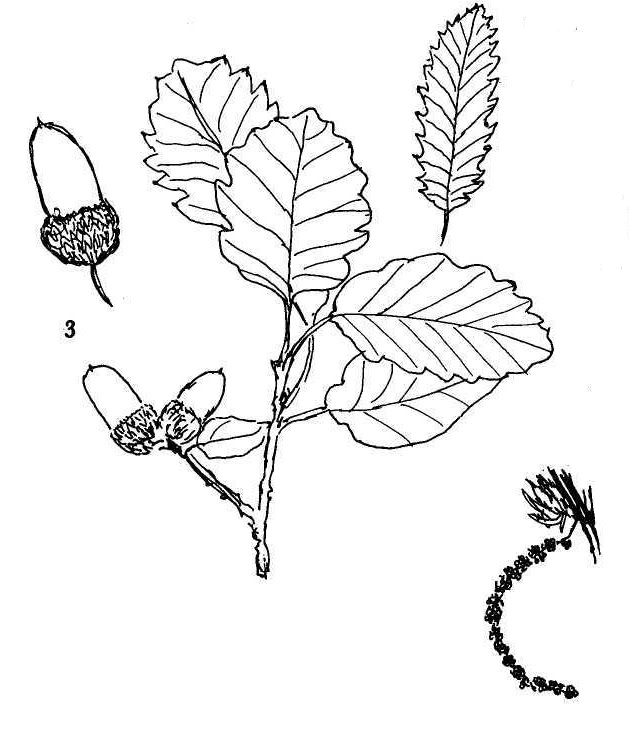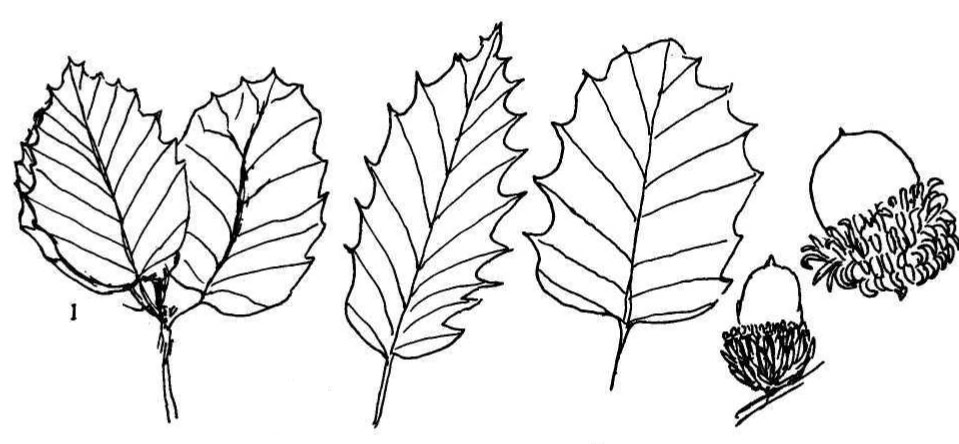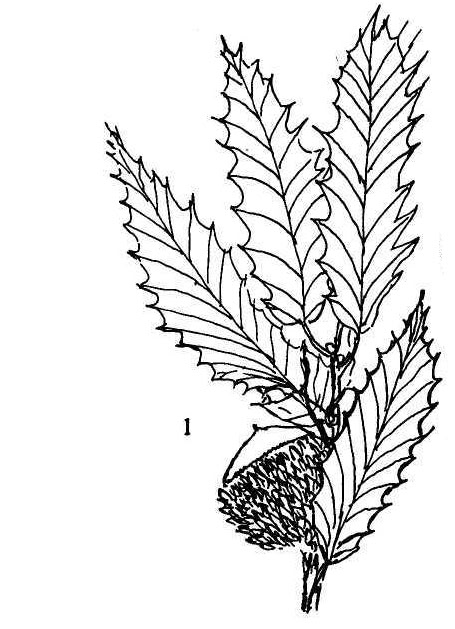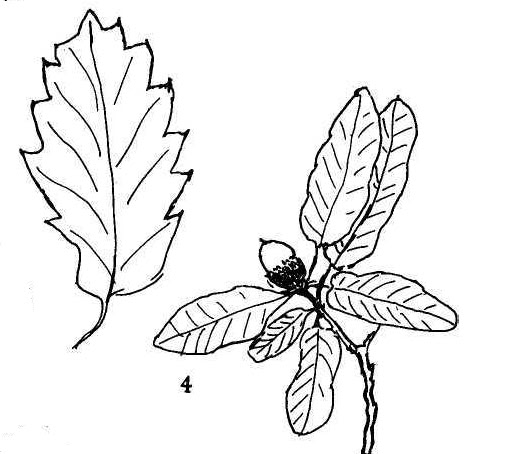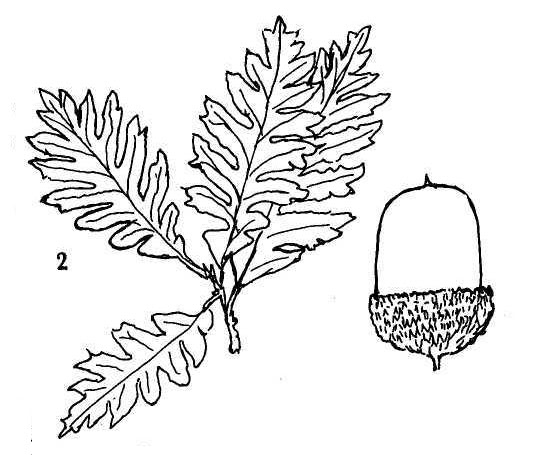Quercus infectoria Oliv. —• Qu. lusitanica Boiss. et Auct., non Lam. (PI.
CXVII, n. 3). —• 5. Arbre
Quercus infectoria Oliv. —• Qu. lusitanica Boiss. et Auct., non Lam. (PI.
CXVII, n. 3). —• 5. Arbre pouvant atteindre et dépasser 10 m., en général peu
rameux et de port peu majestueux lorsqu'il arrive à un grand âge. Écorce grisâtre,
écailleuse, non subéreuse. Rameaux grisâtres, légèrement ou fortement villeuxtomenteux
à l'état jeune, ainsi que les feuilles, glabres ou très brièvement pubérulents
ensuite. Feuilles restant rarement tomenteuses ou pubescentes, devenant d'ordinaire
vite glabres sur les deux faces, avec au plus quelques poils rares près des nervures,
subcoriaces, semipersistantes, à marges plus ou moins régulièrement ondulées, dentées-
mucronées, régulièrement ou non, ou diversement crénelées, ou encore subentières,
mais sinueuses, parfois enfin tout à fait entières, plus ou moins larges par
rapport à leur longueur et de taille assez variable, mais jamais vraiment lobées.
Pétiole de longueur variable, de 5 mm. à 2 cm. Chatons à involucres tomenteux,
un peu lâches. Chatons courts. Pédoncule fructifère de longueur variable, très
courts ou jusqu'à 2 cm. Glands à cupules grises serrées, plus ou moins longuement
dépassées par le gland, formées d'écaillés apprimées.
Le classement de cette espèce polymorphe a été compris de manières bien différentes.
BOISSIER l'identifiait au Quercus faginea Lam., qu'il appelait le plus souvent, dans ses étiquettes
et ses ouvrages, Qu. lusitanica Lam., d'Espagne, du Portugal, des Baléares et d'Afrique du Nord,
Chêne dont il est voisin, mais qui est aujourd'hui tenu pour spécifiquement distinct, sans que les
caractères qui les séparent soient nettement définis. Il semble que l'arbre occidental soit de plus
grande taille et porte des feuilles plus constamment un peu villeuses. Les deux espèces en tout cas
sont très variables.
Le problème posé depuis lors est celui de l'unité d'espèce entre le Qu. infectoria Oliv., considéré
comme typique en Anatolie, au Caucase, en d'autres régions au nord de notre territoire, et l'ensemble
formé par les variétés boissieri, petiolaris et latifolia, groupé dans la monographie de A. CAMUS SOUS
une sous-espèce boissieri (Reut.) n. comb., tandis que ce même nom est élevé au rang d'espèce collective
par O. SCHWARZ.
Les constatations faites sur le terrain et dans les herbiers conservés à Beyrouth, jointes à une
étude attentive du texte des Diagnoses de BOISSIER et du grand ouvrage de KOTSCHY confirment
assez mal cette interprétation. A titre au moins provisoire, il a paru préférable de maintenir avec
NABELEK, au rang de variétés ces trois formes, sans donner d'une façon un peu arbitraire au taxon
Qu. boissieri une valeur collective, et sans tenir pour acquis que la démarcation entre Vinfectoria
anatolien et l'arbre libano-syrien soit aussi nette et aussi définitive que le supposent ces deux
spécialistes.
La forme typique d'infectoria Oliv. serait, du moins d'après A. CAMUS, définie par rapport à
la ssp. boissieri par deux caractères, l'axe fructifère court ou nul, et les jeunes rameaux glabrescents,
tandis que les feuilles, à bords dentés, ne seraient même pas totalement glabres à l'état avancé.
Et cette race, croissant à Stamboul et en Turquie, voire au Caucase, ne se répandrait pas plus au
sud. Est-ce bien établi? Les exsiccata de branches très jeunes sont rares dans les collections, et
cependant celle du Consul BLANCHE en contient un, récolté en plein Liban, aux Cèdres de Hadeth,
bien typique pour le reste, à tomentum très réduit. D'autre part la feuille adulte du Chêne
libanais ou syrien est, elle aussi, très glabre, à poils très rares, voire introuvables, sur les deux faces.
Uinfectoria authentique est-il décidément tout à fait étranger à notre flore, et l'arbre qui en tient la
place en Syrie et au Liban s'en distingue-t-il ou non par des caractères importants et fixes?
Var. boissieri (Reut.) Nabelek — Qu. boissieri Reut., Qu. lusitanica Lam., var.
boissieri (Reut.) Boiss., dans Flora orientalis, Qu. infectoria Oliv., ssp. boissieri, var.
eu-boisseri A. Camus. — La description originale de REUTER est établie d'après unerécolte faite au Cassius. Les rameaux jeunes y sont dits «striatis puberulis», ce qui
n'invite pas à insister sur la forte villosité de ce type. Les feuilles de cet arbre, de
moyenne taille, seraient plus grandes que la moyenne d'infectoria, à pétioles longs
de 12-15 mm., le limbe mesurant lui-même 2 à 5 pouces de long sur -1 pouce de
large (5 à 7 cm. sur 1-2), et doté de dents fortes et régulières. Les pédoncules
fructifères un peu plus longs que les pétioles portent de 2 à 4 glands.
Incontestablement cette variété à dents régulières, à limbe relativement étroit
atténué aux deux extrémités, est très fréquente dans nos contrées, surtout peut-être
au Liban. Elle passe par des transitions à la suivante et ne constitue pas de peuplements
homogènes distincts.
Var. latifolia (Boiss.) Nabelek — Qu. syriaca Ky., Qu. tauricola Ky ?, Qu. infectoria,
ssp. boissieri, var. latifolia (Boiss.) A. Camus. — Sous ce nom BOISSIER fait
entrer des Chênes à feuilles larges, soit dentées plus ou moins régulièrement, soit
crénelées ou subentières («subintegris», non «integerrimis»\). Mêlée à boissieri, cette
variété s'en distingue par ses feuilles non atténuées à la base et au sommet, plus
larges par rapport à leur longueur, par exemple 5 cm. de long sur 3 de large,
ou 10 cm. sur 6. Les marges suivant les arbres ou la place de la feuille sur le même
arbre peuvent être dentées, plus ou moins régulièrement, ou crénelées, ou entières
mais irrégulières et très ondulées, dessinant des angles obtus ou des courbes mal définies.
Il serait fastidieux et sans doute peu utile de cataloguer ou de rechercher sur
le terrain ces variantes, comme d'ailleurs celles du gland, souvent bien plus long
que la cupule. L'axe fructifère n'est pas sensiblement différent dans ces formes de
ce qu'il est chez boissieri.
Ces deux variétés, la seconde risquant parfois de réaliser de très près Yinfectoria
type, paraissent constituer à elles deux tout ce qui doit, au Liban et en Syrie, être
attribué à cette espèce, la seconde en fréquence des Quercus de nos contrées.
Floraison: mars-avril. Boisements ou arbres isolés.
L. Ct. Peu fréquent au-dessous de 200 m. Beyrouth (P), Nahr-el-Kelb (Pb), Nahr Abou'Ali
(Bl), entre Ras Chekka et Hamate (Wall). Mi. Très fréquent. Mansouriyé (Mt), Broummana (Np),
Broummana à Beit Méri (Bnm, sous var. erioclada), Qrayé (Np), Rayfoun (Wall), Baïno (P), Jamhour
(Mt), Bikfaya (Mt). Mm. Mayrouba (P), Cèdres de Barouk (Np), Ehmej, Jab. Qamou'a (Pb),
Cèdres de Hadeth, Bân, Dennié (Bl).. Ve. Boisements de 'Ammiq, en grande quantité, Hazerta (Mt).
A.L. Ouadi-el-Harir,(Hfstr, Mt).
S. Ct. Nahr Snobar (Dlb, très tomenteux), Sud de Lattaquié (Pb). Mi-Mm. Slenfé (Sam,
Dlb, Pb). Sud. Vers Qneitra (Dlb, Pb). A.L. Ouadi-el-Qarn, en avancée extrême (Wall, Mt).
K.D. Bulbul (Pb). NLatt. Chakrourane (Pb).
Aire géogr. — Stamboul, Chypre, Turquie, Caucase, Syrie, Liban, Palestine, TransJordanie.
Il semblerait que BORNMULLER ait créé une var. erioclada à partir de spécimens plus ou moins
nombreux où il avait remarqué la grande villosité au moins fréquente des jeunes rameaux de ce Chêne
au Liban. Il faut probablement en distinguer le fait bien plus rare de rameaux avancés porteurs
de feuilles nettement pubescentes sur les deux faces. Tel est celui figurant à mon herbier de la récolte
de DELBÈS à Nahr Snobar, doté, comme assez souvent le groupe latifolia, de limbes de grande taille.
Quercus infectoria Oliv., var. petiolaris (Boiss.) Nabelek — Qu. petiolaris Boiss. et
Reut., Qu. lusitanica Lam., var. petiolaris (Boiss. et Reut.) Boiss., Qu. infectoria, ssp.
boissieri, var. petiolaris A. Camus, Qu. pfaeffingeri Ky. — Ce Chêne est décrit dans la
Diagnose originale comme vraiment arborescent, à feuilles dotées d'un pétiole mesurant
6-8 lignes, soit 12-20 mm., donc relativement long et de limbes tronqués subcordés à la base, tout à fait entiers (integerrimis) ou parfois grossièrement lobésdentés
et de glands sessiles.
Il s'agit d'un arbre croissant en territoire turc, remarqué d'abord en Carie et
en Pamphylie, au nord de notre territoire, où, semble-t-il, on ne l'a pas jusqu'ici
constaté. Sa présence est probable dans PAmanus.
C'est abusivement, sans nul doute, que A. CAMUS, après avoir transformé la
description et présenté cet arbre comme ayant des feuilles « à bords munis de 5-7
paires de dents, rarement entières» lui attribue de banales récoltes de Yinfectoria
libanais, à Rachaya (major Berton), ou 'Aley et Dimane (Gombault) évidemment
à reverser sous boissieri ou latifolia.
Une autre confusion, trop facile à partir de simples spécimens d'herbier, a consisté
à mettre sous petiolaris un autre Chêne à feuilles également entières, dont nous
allons avoir à traiter, Qu. microphylla
CXVII, n. 3). —• 5. Arbre pouvant atteindre et dépasser 10 m., en général peu
rameux et de port peu majestueux lorsqu'il arrive à un grand âge. Écorce grisâtre,
écailleuse, non subéreuse. Rameaux grisâtres, légèrement ou fortement villeuxtomenteux
à l'état jeune, ainsi que les feuilles, glabres ou très brièvement pubérulents
ensuite. Feuilles restant rarement tomenteuses ou pubescentes, devenant d'ordinaire
vite glabres sur les deux faces, avec au plus quelques poils rares près des nervures,
subcoriaces, semipersistantes, à marges plus ou moins régulièrement ondulées, dentées-
mucronées, régulièrement ou non, ou diversement crénelées, ou encore subentières,
mais sinueuses, parfois enfin tout à fait entières, plus ou moins larges par
rapport à leur longueur et de taille assez variable, mais jamais vraiment lobées.
Pétiole de longueur variable, de 5 mm. à 2 cm. Chatons à involucres tomenteux,
un peu lâches. Chatons courts. Pédoncule fructifère de longueur variable, très
courts ou jusqu'à 2 cm. Glands à cupules grises serrées, plus ou moins longuement
dépassées par le gland, formées d'écaillés apprimées.
Le classement de cette espèce polymorphe a été compris de manières bien différentes.
BOISSIER l'identifiait au Quercus faginea Lam., qu'il appelait le plus souvent, dans ses étiquettes
et ses ouvrages, Qu. lusitanica Lam., d'Espagne, du Portugal, des Baléares et d'Afrique du Nord,
Chêne dont il est voisin, mais qui est aujourd'hui tenu pour spécifiquement distinct, sans que les
caractères qui les séparent soient nettement définis. Il semble que l'arbre occidental soit de plus
grande taille et porte des feuilles plus constamment un peu villeuses. Les deux espèces en tout cas
sont très variables.
Le problème posé depuis lors est celui de l'unité d'espèce entre le Qu. infectoria Oliv., considéré
comme typique en Anatolie, au Caucase, en d'autres régions au nord de notre territoire, et l'ensemble
formé par les variétés boissieri, petiolaris et latifolia, groupé dans la monographie de A. CAMUS SOUS
une sous-espèce boissieri (Reut.) n. comb., tandis que ce même nom est élevé au rang d'espèce collective
par O. SCHWARZ.
Les constatations faites sur le terrain et dans les herbiers conservés à Beyrouth, jointes à une
étude attentive du texte des Diagnoses de BOISSIER et du grand ouvrage de KOTSCHY confirment
assez mal cette interprétation. A titre au moins provisoire, il a paru préférable de maintenir avec
NABELEK, au rang de variétés ces trois formes, sans donner d'une façon un peu arbitraire au taxon
Qu. boissieri une valeur collective, et sans tenir pour acquis que la démarcation entre Vinfectoria
anatolien et l'arbre libano-syrien soit aussi nette et aussi définitive que le supposent ces deux
spécialistes.
La forme typique d'infectoria Oliv. serait, du moins d'après A. CAMUS, définie par rapport à
la ssp. boissieri par deux caractères, l'axe fructifère court ou nul, et les jeunes rameaux glabrescents,
tandis que les feuilles, à bords dentés, ne seraient même pas totalement glabres à l'état avancé.
Et cette race, croissant à Stamboul et en Turquie, voire au Caucase, ne se répandrait pas plus au
sud. Est-ce bien établi? Les exsiccata de branches très jeunes sont rares dans les collections, et
cependant celle du Consul BLANCHE en contient un, récolté en plein Liban, aux Cèdres de Hadeth,
bien typique pour le reste, à tomentum très réduit. D'autre part la feuille adulte du Chêne
libanais ou syrien est, elle aussi, très glabre, à poils très rares, voire introuvables, sur les deux faces.
Uinfectoria authentique est-il décidément tout à fait étranger à notre flore, et l'arbre qui en tient la
place en Syrie et au Liban s'en distingue-t-il ou non par des caractères importants et fixes?
Var. boissieri (Reut.) Nabelek — Qu. boissieri Reut., Qu. lusitanica Lam., var.
boissieri (Reut.) Boiss., dans Flora orientalis, Qu. infectoria Oliv., ssp. boissieri, var.
eu-boisseri A. Camus. — La description originale de REUTER est établie d'après unerécolte faite au Cassius. Les rameaux jeunes y sont dits «striatis puberulis», ce qui
n'invite pas à insister sur la forte villosité de ce type. Les feuilles de cet arbre, de
moyenne taille, seraient plus grandes que la moyenne d'infectoria, à pétioles longs
de 12-15 mm., le limbe mesurant lui-même 2 à 5 pouces de long sur -1 pouce de
large (5 à 7 cm. sur 1-2), et doté de dents fortes et régulières. Les pédoncules
fructifères un peu plus longs que les pétioles portent de 2 à 4 glands.
Incontestablement cette variété à dents régulières, à limbe relativement étroit
atténué aux deux extrémités, est très fréquente dans nos contrées, surtout peut-être
au Liban. Elle passe par des transitions à la suivante et ne constitue pas de peuplements
homogènes distincts.
Var. latifolia (Boiss.) Nabelek — Qu. syriaca Ky., Qu. tauricola Ky ?, Qu. infectoria,
ssp. boissieri, var. latifolia (Boiss.) A. Camus. — Sous ce nom BOISSIER fait
entrer des Chênes à feuilles larges, soit dentées plus ou moins régulièrement, soit
crénelées ou subentières («subintegris», non «integerrimis»\). Mêlée à boissieri, cette
variété s'en distingue par ses feuilles non atténuées à la base et au sommet, plus
larges par rapport à leur longueur, par exemple 5 cm. de long sur 3 de large,
ou 10 cm. sur 6. Les marges suivant les arbres ou la place de la feuille sur le même
arbre peuvent être dentées, plus ou moins régulièrement, ou crénelées, ou entières
mais irrégulières et très ondulées, dessinant des angles obtus ou des courbes mal définies.
Il serait fastidieux et sans doute peu utile de cataloguer ou de rechercher sur
le terrain ces variantes, comme d'ailleurs celles du gland, souvent bien plus long
que la cupule. L'axe fructifère n'est pas sensiblement différent dans ces formes de
ce qu'il est chez boissieri.
Ces deux variétés, la seconde risquant parfois de réaliser de très près Yinfectoria
type, paraissent constituer à elles deux tout ce qui doit, au Liban et en Syrie, être
attribué à cette espèce, la seconde en fréquence des Quercus de nos contrées.
Floraison: mars-avril. Boisements ou arbres isolés.
L. Ct. Peu fréquent au-dessous de 200 m. Beyrouth (P), Nahr-el-Kelb (Pb), Nahr Abou'Ali
(Bl), entre Ras Chekka et Hamate (Wall). Mi. Très fréquent. Mansouriyé (Mt), Broummana (Np),
Broummana à Beit Méri (Bnm, sous var. erioclada), Qrayé (Np), Rayfoun (Wall), Baïno (P), Jamhour
(Mt), Bikfaya (Mt). Mm. Mayrouba (P), Cèdres de Barouk (Np), Ehmej, Jab. Qamou'a (Pb),
Cèdres de Hadeth, Bân, Dennié (Bl).. Ve. Boisements de 'Ammiq, en grande quantité, Hazerta (Mt).
A.L. Ouadi-el-Harir,(Hfstr, Mt).
S. Ct. Nahr Snobar (Dlb, très tomenteux), Sud de Lattaquié (Pb). Mi-Mm. Slenfé (Sam,
Dlb, Pb). Sud. Vers Qneitra (Dlb, Pb). A.L. Ouadi-el-Qarn, en avancée extrême (Wall, Mt).
K.D. Bulbul (Pb). NLatt. Chakrourane (Pb).
Aire géogr. — Stamboul, Chypre, Turquie, Caucase, Syrie, Liban, Palestine, TransJordanie.
Il semblerait que BORNMULLER ait créé une var. erioclada à partir de spécimens plus ou moins
nombreux où il avait remarqué la grande villosité au moins fréquente des jeunes rameaux de ce Chêne
au Liban. Il faut probablement en distinguer le fait bien plus rare de rameaux avancés porteurs
de feuilles nettement pubescentes sur les deux faces. Tel est celui figurant à mon herbier de la récolte
de DELBÈS à Nahr Snobar, doté, comme assez souvent le groupe latifolia, de limbes de grande taille.
Quercus infectoria Oliv., var. petiolaris (Boiss.) Nabelek — Qu. petiolaris Boiss. et
Reut., Qu. lusitanica Lam., var. petiolaris (Boiss. et Reut.) Boiss., Qu. infectoria, ssp.
boissieri, var. petiolaris A. Camus, Qu. pfaeffingeri Ky. — Ce Chêne est décrit dans la
Diagnose originale comme vraiment arborescent, à feuilles dotées d'un pétiole mesurant
6-8 lignes, soit 12-20 mm., donc relativement long et de limbes tronqués subcordés à la base, tout à fait entiers (integerrimis) ou parfois grossièrement lobésdentés
et de glands sessiles.
Il s'agit d'un arbre croissant en territoire turc, remarqué d'abord en Carie et
en Pamphylie, au nord de notre territoire, où, semble-t-il, on ne l'a pas jusqu'ici
constaté. Sa présence est probable dans PAmanus.
C'est abusivement, sans nul doute, que A. CAMUS, après avoir transformé la
description et présenté cet arbre comme ayant des feuilles « à bords munis de 5-7
paires de dents, rarement entières» lui attribue de banales récoltes de Yinfectoria
libanais, à Rachaya (major Berton), ou 'Aley et Dimane (Gombault) évidemment
à reverser sous boissieri ou latifolia.
Une autre confusion, trop facile à partir de simples spécimens d'herbier, a consisté
à mettre sous petiolaris un autre Chêne à feuilles également entières, dont nous
allons avoir à traiter, Qu. microphylla